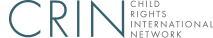Soumis par Louise le
[14 September 2015] - Les récentes études internationales de l'OMS ainsi que l’enquête Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte, conduite en France auprès de plus de 1200 victimes par notre association Mémoire Traumatique et Victimologie, et présentée le 2 mars 2015 avec le soutien de l’ UNICEF France (dans le cadre de son action internationale #ENDViolence) convergent dans le terrible constat d'une absence de protection et de reconnaissance de la très grande majorité des enfants victimes de violences sexuelles, et d’une prise en charge non seulement très insuffisante, mais fréquemment maltraitante.
I Loi du silence, déni, absence de protection et de reconnaissance, injustice et maltraitance.
Les principales victimes de violences sexuelles sont les enfants, les filles étant trois à six fois plus exposées que les garçons. Les enfants sont une cible privilégiée des prédateurs sexuels qui opèrent toujours dans des contextes d’inégalité, de domination masculine et de déni de droits. Ils sont vulnérables, sans défense, dépendants et soumis à l’autorité des adultes. Il est facile de les manipuler, de les menacer et de les contraindre au silence. En raison de leur immaturité, il leur est beaucoup plus difficile d’identifier ce qu’ils ont subi et ils sont rarement considérés comme crédibles quand ils arrivent à parler. De plus, l’impact traumatique très grave présent chez tous les enfants victimes, au lieu de permettre de repérer qu’ils ont subi des violences, de les protéger et de les soigner, assure au contraire une totale impunité aux agresseurs par un retournement pervers lié à la non reconnaissance des symptômes psychotraumatiques : les enfants traumatisés seront considérés comme des enfants difficiles, agités, bizarres, peureux, timides, ayant des troubles du comportement, des troubles de la personnalité, des déficiences intellectuelles, des symptômes psychiatriques, etc.
Les enfants victimes de violences sexuelles sont, pour leur très grande majorité, contraints au silence et totalement abandonnés à leur sort, 83 % dans notre enquête (enquête IVSEA, 2015) déclarent n’avoir jamais été ni protégés, ni reconnus. 4% seulement des enfants victimes de violences sexuelles rapportent avoir bénéficié d’un suivi par les services de protection de l’enfance (enquête IVSEA, 2015). Non seulement les enfants victimes se retrouvent à survivre seuls face à des violences auxquelles il leur est impossible d'échapper, mais ils sont également condamnés, avec des stratégies épuisantes et handicapantes, à survivre seuls aux graves conséquences psychotraumatiques qu'elles entraînent à court, moyen et long termes (Anda, 2006 ; MacFarlane, 2010), et plus particulièrement à leur symptôme principal - la mémoire traumatique - qui, leur faisant revivre les violences à l'identique, s'apparente à une véritable torture qui n'en finit pas.
Le peu d’enfants victimes qui révèlent ce qu’ils ont subi courent le risque de ne pas être crus, d’être mis en cause et maltraités. Ils sont confrontées à une incompréhension de leurs souffrances et de leurs difficultés, que ce soit de la part de leur entourage et des professionnels censés les prendre en charge. Pire, les symptômes traumatiques qu’ils présentent, sont souvent utilisés pour mettre en cause leur parole. Et lorsqu’un proche ou un professionnel protecteur les croit et essaie de les protéger, il se retrouve, lui aussi, trop souvent mis en en cause et maltraité. Le projecteur est braqué avant tout sur les victimes et leurs proches protecteurs au lieu de l’être sur les agresseurs, et nous assistons à des raisonnements organisant un déni généralisé des violences sexuelles.
Loi du silence et déni règnent en maître sur ces violences sexuelles, et bénéficient pour se déployer : de la méconnaissance de la réalité de ces violences et de leur minimisation avec une grave confusion entre violences, sexualité, éducation et amour ; de l’omniprésence d’idées fausses et de stéréotypes que l’on nomme «culture du viol» et qui mettent en cause les victimes, les considérant comme ayant soit menti, soit provoqué et consenti au viol, et innocentent les agresseurs ; ainsi que de la méconnaissance de l’impact traumatique sur les victimes, de leurs conséquences sur la santé des victimes de l’enfance à l’âge adulte, sur leur vie sociale, affective et sexuelle, sur l'apprentissage, les capacités cognitives, la vie professionnelle, sur les risques de précarité et de marginalisation et les risques d'être à nouveau victime de violences, plus de 70% des enfants victimes de violences sexuelles en subiront à nouveau (IVSEA, 2015), ou d'en être auteur (l'OMS a reconnu en 2010 que la principale cause pour subir ou commettre des violences est d'en avoir déjà subi).
Cette méconnaissance de l’impact traumatique des violences sur les victimes est due à un manque très important d’information et de formation (les professionnels de la santé ne reçoivent quasiment aucune formation en initiale et très peu de formation continue), elle explique à quel point la souffrance des victimes est occultée et à quel point rares sont ceux qui se préoccuperont de les réconforter et de leur prodiguer des soins. Quand les victimes vont très mal, les symptômes qu’elles présentent, au lieu d’être reliés aux violences et au trauma, sont attribués à une pathologie psychiatrique sous-jacente, les renvoyant à un statut de malades mentales… ; et quand les victimes semblent ne pas aller si mal, parce qu’elles sont très dissociées et anesthésiées émotionnellement, les violences même les plus extrêmes sont minimisées, ce n’est pas si grave, ou bien, elles sont inventées…
Comme nous allons le voir, les symptômes psychotraumatiques qui traduisent une grande souffrance chez les enfants et les adolescents victimes de violence, sont le plus souvent interprétés comme provenant de l'enfant, de sa nature, de son sexe, de ses origines, de son handicap, de sa personnalité, de sa mauvaise volonté, de ses provocations… Et plutôt que de relier ces troubles à des violences, de nombreuses rationalisations vont chercher à les expliquer par la crise d'adolescence, les mauvaises fréquentations, l'influence de la télévision, d'internet…, ou par la malchance et la fatalité, voire même par l'influence délétère d'une sur-protection : " on l'a trop pourri, gâté, c'est un enfant roi !! ". L'hérédité peut être également appelée à la rescousse : " il est comme… son père, son oncle, sa grand mère, etc. ", ainsi que la maladie mentale. C'est avec ces rationalisations que les suicides des enfants et des adolescents, les jeux dangereux ou les conduites addictives, le plus souvent liés à des violences subies, seront mis sur le compte d'une contagion ou de dépressions.
Très fréquemment, devant un enfant en grande souffrance avec des troubles du comportement et des conduites à risque, les adultes censés le prendre en charge auront recours à des discours moralisateurs et culpabilisants : " tu ne dois pas te conduire comme cela…, regarde la peine que tu fais à tes parents…, avec tout ce que l'on fait pour toi… ", au lieu de se demander ce que cet enfant a bien pu subir, et de lui poser la question qui devrait être systématique : "est-ce que tu as subi des violences ? "
Il y a une véritable incapacité à penser les violences et donc à les reconnaître, mais également à les entendre lorsqu'elles sont révélées. La révélation entraîne un tel stress émotionnel chez la plupart des personnes qui reçoivent la parole des victimes, qu’elles vont souvent mettre en place des systèmes de protection d’une efficacité redoutable. De plus, cette révélation remet en cause l’opinion favorable qu’elles pouvaient avoir des agresseurs. Le refus d’intégrer que de telles violences aient lieu dans des espaces que l’on pensait protecteurs et fiables, le sentiment d’horreur face à des crimes et des délits qui les rendent impensables et inconcevables, particulièrement quand ils sont commis sur des tout-petits, la peur des conséquences d'une dénonciation des violences, font que par angoisse, lâcheté ou complicité, tout sera mis en place pour dénier les violences et imposer le silence aux victimes.
Tout le monde pense que le viol et les agressions sexuelles existent, tout comme les incestes et la pédocriminalité, que c’est grave pour les victimes et que les violeurs, les incestueurs, les pédocriminels doivent être fermement condamnés. Mais dans le système de dénégation où nous baignons, ils n’est pas possible que les violences sexuelles existent « dans notre monde, dans notre entourage, chez nous, dans notre famille, dans nos couples, dans notre univers professionnel, dans nos institutions, chez ceux que nous côtoyons et encore moins chez ceux que nous admirons… ». Elles existent mais seulement dans un espace social de personnes « peu civilisées, marginalisées, sans éducation, malades mentales… ». Si pour quelques crimes sexuels médiatisés, l’opprobre est général, pour tous les autres, l’immense majorité, aucune dénonciation, ni indignation ne sont au rendez-vous. Les violences sexuelles sont ignorées et les victimes n’existent pas, considérées comme des menteuses, des folles, ou bien comme des séductrices - des « lolitas » - capables par leurs conduites provocantes, de pervertir des personnes bien sous tout rapport. De toute façon dans ce système, tout sera de leur faute, même si l’agression ou le viol sont avérés, et que la victime ne peut pas être considérée comme menteuse, elle est malgré tout fautive : de s'être exposée, d'avoir provoqué, de l'avoir cherché, d'être celle par qui le scandale arrive, d'être celle qui détruit tout, qui n'est pas capable de se relever, de tourner la page, de pardonner, d'aller mieux… (Gryson-Dejehansart, 2009 ; Salmona, 2013)
Or les crimes et les délits sexuels sont uniformément répandus dans tous les milieux socio-culturels sans exception, 94% de ces violences sont commises par des proches, et 54% par des membres de la famille (IVSA, 2015). Les agresseurs - essentiellement masculins dont le quart sont des mineurs - bénéficient presque toujours d’une totale impunité.
Pour maintenir ce déni, il faut donc faire disparaître les victimes, ce qui a l’avantage de faire disparaître les violences et les agresseurs et de protéger son monde idéalisé : « circulez, il n’y a rien à voir ! ». Soit tout a été inventé, soit, si la réalité des actes sexuels ne peut pas être niée, ce ne sont pas des violences. Pour cela il suffit de les maquiller et de les transformer en sexualité, amour, soins, jeux, etc. D’où le foisonnement de théories pour dire combien les enfants et les femmes peuvent mentir ou présenter des pathologies pouvant les pousser à raconter n’importe quoi : fausses allégations, syndrome d’aliénation parentale, faux souvenirs, troubles mentaux comme l’hystérie, les psychoses, les démences, les troubles de la personnalité, etc. Cela aboutit souvent, comme nous le verrons, à une situation particulièrement perverse et cruelle, où pour décrédibiliser les victimes, on leur tient rigueur de symptômes ou de comportements qui relèvent des conséquences psychotraumatiques normales et universelles de ce qu’elles ont subi, qui en sont des preuves médicales, et que l’on détourne. Le monde à l’envers…
De fait, 11 % seulement des viols font l’objet de plaintes (INSEE - ONDRP, 2010 - 2012) - les rares crimes sexuels qui entraînent une condamnation aux assises, entre 1,5 à 2 % de l’ensemble des viols subis, sont majoritairement ceux qui ont été commis par des personnes issues d’une classe sociale défavorisée, comme l’a montré l’étude sociologique de Véronique Le Gaouziou faite en 2011. Pour les autres, la parole de la victime, son comportement, ses capacités mentales vont être mises en cause pour aboutir à des affaires classées, des non-lieux et des déqualifications en délits ou en atteintes sexuelles (dans ce dernier cas l’enfant est considéré comme ayant consenti aux actes sexuels).
Et c’est ainsi que les droits des enfants victimes de violences sexuelles sont bafoués et qu’ils subissent des injustices en cascade, injustice d'être des victimes de crimes et de délits, injustice d’une non-reconnaissance et d’un manque cruel de solidarité, d’un entourage qui ne veut ni voir, ni savoir, ni entendre, ni dénoncer ce qu'elles subissent dans l'intimité d'une famille, d'une institution, injustice désespérante de voir des agresseurs bénéficier le plus souvent d'une impunité totale, injustice d'être ceux qui se retrouvent condamnés à survivre seuls, à souffrir, à se battre et à devoir se justifier sans cesse, à supporter mépris, critiques et jugements, à entendre des discours moralisateurs et culpabilisants pour des symptômes que personne ne pense à relier aux violences, injustice d’être considérées comme responsables de leur victimisation et de leur propre malheur et injustice d’être abandonnées sans réconfort ni soin.
II Quelle est la réalité de ces violences sexuelles et de leurs conséquences psychotraumatiques :
De toutes les violences sexuelles, celles qui touchent les enfants font partie des plus cachées. Chaque année, nous dit-on, 102 000 adultes sont victimes de viols et de tentatives de viol (86 000 femmes et 16 000 hommes) en France (CVS-ONDRP 2012), mais on ne nous parle pas des victimes mineures pourtant bien plus nombreuses, estimées à 154 000 (124 000 filles et 30 000 garçons). Dans le monde 120 millions de filles (une sur dix) ont subi des viols, et la prévalence des violences sexuelles est de 18% pour les filles et de 7,5% pour les garçons (OMS, 2014).
Selon les résultats de l’enquête IVSEA 2015 : 81% des victimes de violences sexuelles ont subi les premières violences avant l’âge de 18 ans, 51% avant 11 ans, et 23% avant 6 ans.
Or, les violences sexuelles font partie des pires traumas et la quasi-totalité des enfants victimes développeront des troubles psychotraumatiques. Ces traumas ne sont pas seulement psychologiques mais aussi neuro-biologiques avec des atteintes corticales et des altérations des circuits émotionnels et de la mémoire à l’origine d’une dissociation et d’une mémoire traumatique.
Les troubles psychotraumatiques sont, nous l’avons vu, une réponse universelle et normale, présente chez toutes les victimes dans les jours et les semaines qui suivent un traumatisme (McFarlane, 2000), ils s'installent dans la durée si rien n'est fait pour protéger et soigner les victimes. Alors que pour une exposition traumatique en général le risque que s'installent des troubles psychotraumatiques chroniques (un état de stress post-traumatique) est de 24 %, après des violences sexuelles dans l’enfance on retrouve un état de stress post-traumatique dans 87 % des cas (Rodriguez, 1997). Dans les cas de violences sexuelles incestueuses dans l’enfance, ce taux peut même atteindre 100 % (Lindberg, 1985).
L'étude prospective américaine de Felitti et Anda (2010), montre que le principal déterminant de la santé à 55 ans est d'avoir subi des violences dans l'enfance. Les conséquences sur la santé sont à l'aune des violences subies. Plus elles ont été graves et répétées, plus leurs conséquences sur la santé sont importantes : risque de mort précoce par accidents, maladies et suicides (avoir subi des violences dans l’enfance peut faire perdre 20 années d’espérance de vie, Brown, 2009), de maladies cardio-vasculaires et respiratoires, de diabète, d'obésité, d'épilepsie, de troubles de l'immunité, de troubles psychiatriques (dépressions, troubles anxieux, troubles graves de la personnalité), d'addictions, de troubles du sommeil, de l'alimentation et de la sexualité, de douleurs chroniques invalidantes, de troubles cognitifs etc (toutes ces conséquences sont très bien documentées).
Notre enquête Impact des violences sexuelle de l’enfance à l’âge adulte montre que les conséquences sur la santé sont à l'aune des violences subies, elles sont d’autant plus importantes que les enfants sont victimes très jeunes (moins de 11 ans), qu’il s’agit de violences sexuelles incestueuses, et que ce sont des viols. 95% des victimes considèrent que les violences ont eu un impact sur leur santé mentale et 70%, un impact sur leur santé physique (IVSEA, 2015).
Et, depuis plus de 10 ans, de nombreuses recherches cliniques et neuro-biologiques ont montré que l’impact des violences sexuelles chez les victimes est non seulement psychologique, mais également neuro-biologique avec des atteintes de circuits neurologiques et des perturbations endocriniennes des réponses au stress (McFarlane, 2010). Ces atteintes ont été, elles aussi, bien documentées, elles laissent des séquelles cérébrales visibles par IRM, avec une diminution de l’activité et du volume de certaines structures (par diminution du nombre de synapses), et pour d’autres une hyperactivité, ainsi qu’une altération du fonctionnement des circuits de la mémoire et des réponses émotionnelles. Récemment des altérations épigénétiques ont également été mises en évidence chez des victimes de violences sexuelles dans l’enfance, avec la modification d’un gène (NR3C1) impliqué dans le contrôle des réponses au stress et de la sécrétion des hormones de stress (adrénaline, cortisol), altérations qui peuvent être transmises à la génération suivante (Perroud, 2011).
Et encore plus récemment une étude menée par une équipe internationale de chercheurs d’Allemagne, des États-Unis et du Canada et publiée début juin 2013 dans l’American Journal of Psychiatry (Heim, 2013) a mis en évidence des modifications anatomiques visibles par IRM de certaines aires corticales du cerveau de femmes adultes ayant subi dans l’enfance des violences sexuelles. Fait remarquable, ces aires corticales qui ont une épaisseur significativement diminuée par rapport à celles de femmes n’ayant pas subi de violences, sont celles qui correspondent aux zones somato-sensorielles des parties du corps ayant été touchées lors des violences (zones génitales, anales, buccales, etc.). Et l’épaisseur de ces zones corticales est d’autant plus diminuée que les violences ont été plus graves (viols, plusieurs agresseurs,…).
Ces nombreuses recherches ont déjà permis de faire le lien entre les découvertes neuro-biologiques et la clinique des psychotraumatismes. La compréhension du lien fait appel à l’élaboration d’un modèle théorique (Shin, 2006 ; Yehuda, 2007, Salmona, 2008 et 2012), c’est-à-dire d’une explication qui permet de mieux appréhender la réalité, le modèle ne pouvant prétendre expliquer la réalité dans sa totalité. J’ai participé à cette élaboration qui permet de décrire les mécanismes psychiques et neuro-biologiques à l’œuvre lors des violences, et de donner une explication et une cohérence aux différents symptômes psychotraumatiques qui sinon paraissent paradoxaux, sont difficilement compréhensibles et peuvent être retournés contre les victimes.
1 Les mécanismes psychotraumatiques à l'œuvre
Les violences aboutissent à la constitution d’une mémoire traumatique de l’événement, différente de la mémoire autobiographique normale, non intégrée et piégée dans certaines structures de l’encéphale. Les mécanismes à l’origine de cette mémoire traumatique sont assimilables à des mécanismes exceptionnels de sauvegarde qui sont déclenchés par le cerveau pour échapper au risque vital que fait courir une réponse émotionnelle extrême face à un trauma.
L'enfant confronté à des violences terrorisantes et incompréhensibles, et à un adulte qui soudain se transforme en « monstre » ou se conduit de façon incohérente, se retrouve paralysé psychiquement et physiquement, en état de sidération. Cette sidération visible sur les IRM et qui va lui être souvent reproché «pourquoi tu n’as pas réagi, fui, dit non, etc?», en bloquant son appareil psychique, annihile toute représentation mentale et empêche toute possibilité de contrôle de la réponse émotionnelle.
Cette réponse émotionnelle est déclenchée par une structure cérébrale sous-corticale : l'amygdale cérébrale. Elle s'apparente à une alarme qui s'allume pour que l'on puisse répondre à un danger, lui faire face ou le fuir. Elle déclenche une hypervigilance et la production d'hormones de stress : adrénaline et cortisol qui fournissent l'organisme en "carburant" (oxygène et glucose). Comme toute alarme, par sécurité, elle ne s'éteint pas spontanément, seul le cortex peut la moduler ou l'éteindre grâce à des représentations mentales (intégration, analyse et compréhension de la situation et prise de décisions).
Lors de violences, la sidération et l’immaturité psychique de l’enfant fait que son cortex est dans l'incapacité de moduler l'alarme qui continue donc à « hurler » et à produire une grande quantité d'hormones de stress. L'organisme se retrouve en état de stress extrême, avec des taux toxiques d'hormones de stress qui représentent un risque vital cardiovasculaire (adrénaline) et neurologique (cortisol : avec des atteintes neuronales). Pour échapper à ce risque vital, comme dans un circuit électrique en survoltage qui disjoncte pour protéger les appareils électriques, le cerveau fait disjoncter le circuit émotionnel à l'aide de neurotransmetteurs qui sont des « drogues dures » anesthésiantes et dissociantes (morphine-like et kétamine-like, endorphines et antagonistes des récepteurs de la NDMA).
2 Disjonction du circuit émotionnel et dissociation traumatique
Cette disjonction, en isolant l'amygdale cérébrale, éteint la réponse émotionnelle et fait disparaître le risque vital en créant brutalement un état d'anesthésie émotionnelle et physique. Mais cette disjonction est à l'origine d'une dissociation traumatique, un trouble de la conscience lié à la déconnection avec le cortex, qui entraîne une sensation d'irréalité, d'étrangeté, d’absence, et qui donne à l’enfant l’impression d'être spectateur des événements, de regarder un film.
Grâce à cette dissociation les agresseurs ne sont pas gênés par des signaux de détresse trop importants de leurs victimes, c’est très dangereux pour les enfants car les actes violents pourront devenir de plus en plus extrêmes, sans qu’ils puissent y réagir. L’anesthésie émotionnelle ne les empêchera pas d’être encore plus traumatisés. De plus, comme cette dissociation transforme la victime en automate, l’agresseur en fera ce qu’il veut et pourra facilement lui imposer de participer aux violences et de répéter des phrases de pseudo-consentement : « dis-moi que tu aimes ça, et que c’est ce que tu veux !». L’agresseur pourra arguer qu’il n’a pas commis de violence et que l’enfant était consentant, et les policiers, les gendarmes, les juges, par méconnaissance de ces processus de dissociation pourront reconnaître l’enfant comme consentant, comble de l’injustice… C’est flagrant également lors des viols en réunion d’adolescentes, qui, totalement dissociées, restent sans réaction, ou s’exécute face aux injonctions des violeurs, et passent pour avoir été consentantes.
Cette dissociation traumatique qui peut durer des heures, des jours, des mois, voire des années si l’enfant continue à subir des violences, ou s’il reste en contact avec l’agresseur et ses complices, va faire que l’enfant anesthésié émotionnellement, semblera indifférent, déconnecté en permanence. Alors que chacun a la capacité de percevoir de façon innée les émotions d’autrui, grâce à des neurones miroirs, en face d’une personne anesthésiée il n’y aura pas de ressenti émotionnel, ce n’est qu’intellectuellement qu’il sera possible d’identifier la souffrance de cette personne. Les proches et les professionnels, ne comprenant pas cette dissociation y réagiront par une absence d’empathie, une minimisation des violences subies par l’enfant, et de sa souffrance, une incrédulité, voire une remise en question de sa parole et de la réalité des violences.
De plus, l’enfant dissocié est souvent considéré comme débile, inconséquent, incapable de comprendre ce qui se passe et d’y réagir, et il sera en but à des moqueries, des humiliations et des maltraitances de la part de tous. Dans le film Polisse nous assistons à une scène de ce type avec la jeune ado qui a été obligée de faire des fellations à plusieurs garçons pour récupérer son portable, elle semble si indifférente à la situation que les policiers se permettent de lui faire la leçon et même de se moquer d’elle en lui posant la question : «et si on t’avait pris ton ordinateur portable qu’est-ce que t’aurais fait ?» et toute la salle de cinéma d’éclater de rire…
3 Disjonction des circuits de la mémoire et mémoire traumatique
La disjonction est également à l’origine de troubles de la mémoire par interruption des circuits d’intégration de la mémoire : avec des amnésies partielles ou complètes et surtout une mémoire traumatique.
Cette mémoire traumatique est une mémoire émotionnelle des violences contenue dans l’amygdale cérébrale qui n’a pas pu être traitée par l’hippocampe dont elle est déconnectée. L'hippocampe est une structure cérébrale qui intègre et transforme la mémoire émotionnelle en mémoire autobiographique et verbalisable. Tel un logiciel, l’hippocampe est indispensable pour stocker et aller rechercher les souvenirs et les apprentissages, et pour se repérer dans le temps et l’espace : avec la disjonction ces fonctions seront gravement perturbées.
La mémoire traumatique est au cœur de tous les troubles psychotraumatiques. C'est une mémoire émotionnelle enkystée, une mémoire « fantôme » hypersensible et incontrôlable, prête à « exploser » en faisant revivre à l'identique, avec le même effroi et la même détresse les événements violents, les émotions et les sensations qui y sont rattachées. Elle « explose » aussitôt qu'une situation, un affect ou une sensation rappelle les violences ou fait craindre qu'elles ne se reproduisent. Elle sera comme une « bombe à retardement » susceptible d'exploser souvent des mois, voire de nombreuses années après les violences. Quand elle « explose » elle envahit tout l'espace psychique de façon incontrôlable. Elle transforme la vie psychique en un terrain miné. Telle une "boîte noire" elle contient non seulement le vécu émotionnel, sensoriel et douloureux de la victime, mais également tout ce qui se rapporte aux faits de violences, à leur contexte et à l'agresseur (ses mimiques, ses mises en scène, sa haine, son excitation, ses cris, ses paroles, son odeur, etc).
La mémoire traumatique sera souvent responsable non seulement de sentiments de terreur, de détresse, de mort imminente, de douleurs, de sensations inexplicables, mais également de sentiments de honte et de culpabilité, et d'estime de soi catastrophique qui seront alimentés par la mémoire traumatique des paroles de l'agresseur. Tout y est mélangé, sans identification, ni tri, ni contrôle possible (Van der Hart, 2010). Au moment des violences cette indifférenciation empêchera la victime de faire une séparation entre ce qui vient d’elle et de l’agresseur, elle pourra à la fois ressentir une terreur qui est la sienne, associée à une excitation et une jouissance perverses qui sont celles de l’agresseur. De même il lui sera impossible de se défendre des phrases mensongères et assassines de l’agresseur : «tu aimes ça», «c’est ce que tu veux», «c’est ce que tu mérites», elles s’installeront telles quelles dans l’amygdale cérébrale. Après les violences, cette mémoire traumatique y restera piégée.
Avec cette mémoire traumatique, les victimes contre leur gré se retrouvent à revivre sans cesse les pires instants de terreur, de douleur, de désespoir, comme une torture sans fin, avec des sensations soudaines d'être en grand danger, d'être projetées par terre, d'être écrasées, frappées violemment, de perdre connaissance, de mourir, d'avoir la tête ou le corps qui explose, avec des suffocations, des douleurs intenses. Avec elles, l'agresseur reste éternellement présent à leur imposer les mêmes actes atroces, les mêmes phrases assassines, la même souffrance délibérément induite, la même jouissance perverse à les détruire, leurs mêmes mises en scène mystificatrices avec une haine, un mépris, des injures, et des propos qui ne les concernent en rien. Et plus les violences ont eu lieu tôt dans la vie des victimes, plus elles ont été obligées de se construire avec ces émotions et ces sensations de terreur, avec ces actes et ces propos pervers, à devoir lutter contre eux sans les comprendre et sans ne plus savoir où se trouve la ligne de démarcation entre elles et cette mémoire traumatique. La mémoire traumatique les hante, les exproprie et les empêche d'être elles-mêmes, pire elle leur fait croire qu'elles sont doubles, voire triples : une personne normale (ce qu'elles sont), une moins que rien qui a peur de tout, et une coupable dont elles ont honte et qui mérite la mort (ce que l'agresseur a mis en scène et qu'elles finissent par intégrer puisque cela tourne en boucle dans leur tête), une personne qui pourrait devenir violente et perverse et qu'il faut sans cesse contrôler, censurer (ce même agresseur tellement présent et envahissant à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles finissent par se faire peur en le confondant avec elles-mêmes) (Salmona, 2013, 2015).
Un nouveau-né, un nourrisson traumatisé par des violences sexuelles développera une mémoire traumatique, même s'il ne lui est pas possible de se souvenir des violences (l'hippocampe n'étant fonctionnel pour la mémoire autobiographique qu'à partir de 2-3 ans).
4 Disjonction des circuits de la mémoire et des circuits émotionnels et amnésies traumatiques
C’est chez les victimes de violences sexuelles dans l’enfance que l’on retrouve le plus d’amnésies traumatiques. Ce phénomène peut perdurer de nombreuses années, voire des décennies. 59,3 % des victimes de violences sexuelles dans l’enfance ont des périodes d’amnésie totale ou parcellaire (Brière, 1993).
Des études prospectives aux États-Unis (Williams, 1994, Widom, 1996) ont montré que 17 ans et 20 ans après avoir été reçues en consultation dans un service d’urgence pédiatrique, pour des violences sexuelles documentées qui avaient été répertoriés dans un dossier, 38 % des jeunes femmes interrogées pour la première étude et 40 % pour l’autre ne se rappelaient plus du tout les agressions sexuelles qu’elles avaient subies enfant. Ces amnésies étaient fortement corrélées au fait que l’agresseur était un proche parent que la victime côtoyait au jour le jour, et que les violences avaient été particulièrement brutales.
De même, dans l’enquête IVSEA 2015 de notre association Mémoire Traumatique et Victimologie : Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte, plus d’un tiers (37 %) des victimes mineures au moment des faits rapportent avoir présenté une période d’amnésie traumatique après les violences, ce chiffre monte à 46 %, lorsque les violences sexuelles ont été commises par un membre de la famille. Ces amnésies traumatiques peuvent durer jusqu’à 40 ans et même plus dans 1 % des cas. Elles ont duré entre 21 et 40 ans pour 11 % des victimes, entre 6 et 20 ans pour 29 % d’entre elles et de moins de 1 an à 5 ans pour 42 % d’entre elles.
Toutes les études montrent également que les souvenirs retrouvés sont fiables et en tout point comparables avec des souvenirs traumatiques qui ont toujours été présents chez d’autres victimes, et qu’ils réapparaissaient le plus souvent brutalement et de façon non contrôlée « comme une bombe atomique », avec de multiples détails très précis, et accompagnés d’une détresse, d’un sentiments d’effroi, de sidération et de sensations strictement abominables.
Tant qu’il y aura disjonction et dissociation, la mémoire traumatique sera déconnectée et la victime n’aura pas accès aux événements traumatiques, suivant l’intensité de la dissociation elle pourra en être amnésique partiellement ou totalement.
Mais si la dissociation disparaît, ce qui peut se produire quand la victime est enfin sécurisée, ou bien quand une violence dépasse les capacités de dissociation ou se produit dans un contexte radicalement différent par rapport aux autres violences subies jusque là, alors la mémoire traumatique peut se reconnecter et elle peut "s’allumer" lors de liens rappelant les violences. Elle envahit l’espace psychique de la victime lui faisant revivre les violences comme une machine à remonter le temps.
Cette méconnaissance des phénomènes psychotraumatiques, de la réalité et de la fréquence des violences sexuelles commises sur des mineurs fait que les victimes qui ont des réminiscences traumatiques ne sont le plus souvent pas crues. On leur renvoie qu’il s’agit de fantasmes, d’hallucinations rentrant dans le cadre de psychoses, de bouffées délirantes, de démences ou bien de faux souvenirs.
À la fin des années 1990, aux Etats-Unis, au moment où des plaintes ont commencé à être déposées et prises en compte par les tribunaux après des remémorations, une polémique s’est développée autour d’une association (The False Memory Syndrome Foundation) dénonçant ces remémorations comme étant des faux souvenirs induits par des psychothérapeutes. Cette association décrivait même une épidémie de dénonciations de violences sexuelles dans l’enfance basées sur ce "syndrome des faux souvenirs". Cette contestation reposait sur le fait que des traumatismes aussi graves ne pouvaient pas être oubliés et que des thérapeutes trop zélés greffaient ces faux souvenirs chez leurs patients.
Des scientifiques se sont alors mobilisés pour démontrer que les amnésies traumatiques existaient bel et bien, et qu’elles étaient prouvées par de très nombreuses études dont les études prospectives citées plus haut, et que les souvenirs retrouvés étaient très rarement liés à des remémorations survenues lors de psychothérapies
Cet ensemble impressionnant d’études scientifiques (Hopper J., 2015) a permis d’invalider la théorie des "faux souvenirs", et des enquêtes ont pu démontrer que les chiffres avancés par the False Memory Syndrome Foundation pour justifier d’une épidémie de faux souvenirs déclenchés par des thérapies étaient, eux, réellement faux. Mais le mal était fait, et encore aujourd’hui cette théorie peut être opposée aux victimes.
5 Les stratégies de survie mises en place par les enfants traumatisés.
Les enfants victimes, quand ils sont abandonnées sans protection et qu’ils ne bénéficient ni de solidarité, ni de soutien, ni de soins, sont condamnés à mettre en place des stratégies de survie handicapantes et épuisantes.
Pendant les violences et tant que l’enfant est exposé à l’agresseur, trois mécanismes principaux sont mis en place pour y survivre :
- la fuite, quand elle est possible et c’est rare, elle représente souvent un grand danger pour l’enfant. Une fugue chez un enfant ou un départ précoce du milieu familial chez un adolescent doivent toujours faire rechercher des violences qui pourraient en être à l’origine.
- un mécanisme d’adaptation pour éviter la survenue de violences et le risque de rejet et d’abandon, les enfants s’hyper-adaptent à leurs agresseurs et pour cela ils s’identifient à eux, ils apprennent à percevoir et à anticiper leurs moindres changements d’humeur. Ils deviennent de véritables scanners, capables de décrypter et d’anticiper les besoins de leurs bourreaux. Il est essentiel que ceux-ci ne soient jamais contrariés, ni énervés, ni frustrés, il faut donc les connaître parfaitement, être en permanence attentifs à ce qu’ils font, à ce qu’ils pensent. Ce phénomène peut donner l’impression aux enfants d’être très attachés à leurs bourreaux puisque ces derniers prennent toute la place dans leur tête (syndrome de Stockholm). Les enfants peuvent croire que leurs agresseurs comptent plus que tout pour eux (c’est ce que leur rappelle sans cesse l’agresseur : «je suis tout pour toi, sans moi tu n’es rien…»), et que ce qu’ils ressentent est un sentiment amoureux alors que c’est une réaction d’adaptation à une situation de mise sous terreur.
- un mécanisme neuro-biologique de protection face au stress extrême et à des situations intolérables, qui se met en place automatiquement : la dissociation. Ils sont alors, comme nous l’avons vu, déconnectés de leurs émotions, avec une anesthésie émotionnelle et un seuil de résistance à la douleur très augmenté. Ils se retrouvent à fonctionner sur un mode automatique, comme robotisés, détachés d’eux-mêmes, comme s’ils étaient spectateurs. Cela entraîne une pseudo-tolérance à l’intolérable : «même pas mal !». Tant que dure cette dissociation, la situation paraît irréelle et il est très difficile pour les enfants d’arriver à identifier la gravité des violences qu’ils subissent. De plus cette dissociation traumatique fera que face aux agresseurs ou à toute autre personne, les enfants paraîtront indifférents à leur sort, inertes, puisqu’ils seront coupés de leurs émotions. De même les proches et les professionnels ne détecteront pas facilement la détresse et la souffrance des enfants, et passeront d’autant plus à côté. Enfin, comme nous l’avons vu, cette dissociation est un facteur de risque important d’être maltraité, de devenir le souffre-douleur de tout le monde.
Après les violences et à distance de l’agresseur, les enfants sortent de leur état dissociatif permanent mais la mémoire traumatique prend le relais et ils continuent d’être colonisés par les violences et l’agresseur aussitôt qu’un lien les rappelle (lieu, situation, sensation, émotion,…). Et c’est à nouveau insupportable et donne l’impression de sombrer dans la folie. Les victimes traumatisées doivent alors essayer d’éviter à tout prix cette mémoire traumatique, pour cela deux stratégies sont possibles :
- des conduites d’évitement, d’hypervigilance et de contrôle que l'enfant met en place pour éviter les déclenchements effrayants de sa mémoire traumatique, vis-à-vis de tout ce qui est susceptible de la faire « exploser » (avec des angoisses de séparation, des comportements régressifs, un retrait intellectuel, des phobies et des troubles obsessionnels compulsifs comme des lavages répétés ou des vérifications incessantes, une intolérance au stress), il va fréquemment se créer un petit monde sécurisé parallèle où il se sentira en sécurité qui peut être un monde physique (comme sa chambre, entouré d’objets, de peluches ou d’animaux qui le rassure) ou mental (un monde parallèle où il se réfugie continuellement).Tout changement sera perçu comme menaçant car mettant en péril les repères mis en place et il adoptera des conduites d'hypervigilance (avec une sensation de peur et de danger permanent, un état d'alerte, une hyperactivité, une irritabilité et des troubles de l'attention). Ces conduites d’évitement et d’hypervigilance sont épuisantes et envahissantes, elles entraînent des troubles cognitifs (troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire) qui ont souvent un impact négatif sur la scolarité et les apprentissages. Mais les enfants traumatisés sont souvent contrecarrés dans leurs conduites d'évitement et de contrôle par un monde adulte qui ne comprend rien à ce qu'ils ressentent. Ils doivent s'autonomiser et s'exposer à ce qui leur fait le plus peur, comme être séparé d'un parent ou d'un adulte protecteur, dormir seul dans le noir, être confronté à son agresseur ou à quelqu'un qui lui ressemble, à des situations nouvelles et inconnues, etc. Quand un enfant n'est pas sécurisé et n'a pas la possibilité de mettre en place des conduites d'évitement efficaces, sa mémoire traumatique va exploser fréquemment ce qui le plonge à chaque fois dans une grande détresse jusqu'à ce qu'il se dissocie par disjonction, mais du fait d'une accoutumance aux drogues dissociantes sécrétées par le cerveau, le circuit émotionnel va de moins en moins pouvoir disjoncter, ce qui engendre une détresse encore plus intolérable qui ne pourra être calmée ou prévenue que par des conduites à risque dissociantes.
- des conduites à risque dissociantes dont l'enfant et l'adolescent expérimentent rapidement l'efficacité servent à provoquer « à tout prix » une disjonction pour éteindre de force la réponse émotionnelle en l’anesthésiant et calmer ainsi l'état de tension intolérable ou prévenir sa survenue. Cette disjonction provoquée peut se faire de deux façons, soit en provoquant un stress très élevé qui augmentera la quantité de drogues dissociantes sécrétées par l'organisme, soit en consommant des drogues dissociantes (alcool, stupéfiants). Ces conduites à risques dissociantes sont des conduites auto-agressives (se frapper, se mordre, se brûler, se scarifier, tenter de se suicider), des mises en danger (conduites routières dangereuses, jeux dangereux, sports extrêmes, conduites sexuelles à risques, situations prostitutionnelles, fugues, fréquentations dangereuses), des conduites addictives (consommation d'alcool, de drogues, de médicaments, troubles alimentaires, jeux addictifs), des conduites délinquantes et violentes contre autrui (l'autre servant alors de fusible grâce à l'imposition d'un rapport de force pour disjoncter et s'anesthésier). Les conduites à risques sont donc des mises en danger délibérées. Elles consistent en une recherche active voire compulsive de situations, de comportements ou d'usages de produits connus comme pouvant être dangereux à court ou à moyen terme. Le risque est recherché pour son pouvoir dissociant direct (alcool, drogues) ou par le stress extrême qu'il entraîne (jeux dangereux), et sa capacité à déclencher la disjonction de sauvegarde qui va déconnecter les réponses émotionnelles et donc créer une anesthésie émotionnelle et un état dissociatif. Mais elles rechargent aussi la mémoire traumatique, la rendant toujours plus explosive, et rendant les conduites dissociantes toujours plus nécessaires, créant une véritable addiction aux mises en danger et/ou à la violence (Salmona, 2012, 2013, 2015).
Les conduites dissociantes sont incompréhensibles et paraissent paradoxales à tout le monde (à la victime, à ses proches, aux professionnels). Elles sont chez les victimes à l'origine de sentiments de culpabilité et d'une grande solitude, qui les rendent encore plus vulnérables. Et elles sont, du côté des proches et des professionnels, souvent à l’origine de rejet, d’incompréhension, voire de maltraitances. Elles peuvent entraîner un état dissociatif permanent comme lors des violences avec la mise en place d’un détachement et d’une indifférence apparente qui les mettent en danger d’être encore moins secourues et d’être ignorées et encore plus maltraitées. De plus cet état dissociatif donne aux victimes la douloureuse impression de n’être pas elles-mêmes, comme dans une mise en scène permanente. L’anesthésie émotionnelle les oblige à «jouer» des émotions dans les relations avec les autres, avec le risque de n’être pas tout en fait en phase, de sur ou sous-jouer.
6 Des risques d’auto-agressions, de suicides, et de subir à nouveau des violences ou d’en reproduire
La mémoire traumatique et les conduites dissociantes peuvent être à l’origine de risques vitaux, avec un risque décuplé de mourir précocement d’accident (avec les mises en danger, cf les travaux de Jacqueline Cornet, 1997) ou de suicide. Dans l’enquête d’AIVI (l’Association internationale des victimes d’inceste) et dans le questionnaire de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie (rapport IVSEA, 2015), 50% des victimes de violences sexuelles dans l’enfance ont fait des tentatives de suicide.
Si certaines tentatives de suicide peuvent être liées à une volonté réfléchie d’en finir avec une vie de souffrance, la plupart sont dues à la mémoire traumatique de la volonté destructrice et criminelle de l’agresseur qui, en envahissant le psychisme de la personne victime, peut la faire brutalement basculer dans un passage à l’acte suicidaire. Celui-ci reproduit soit une tentative de meurtre subie par le passé, soit le «tu ne vaux rien, tu n’es rien, tu ne mérites pas de vivre, tu es indigne, tu n’es qu’un déchet à jeter, etc.» mis en scène par l’agresseur. La victime est colonisée par le désir meurtrier de l’agresseur qui s’impose à elle, comme s’il émanait de ses propres pensées. C’est intolérable, et répondre à cette injonction en se supprimant, dans une compulsion dissociante, devient la seule solution pour échapper à cette scène et pour éteindre cette violence qui explose en elle.
Du fait de ces conduites dissociantes à risque, laisser des victimes de violences traumatisées sans soin est un facteur de risque de reproduction de violences de proche en proche et de génération en génération, les victimes présentant un risque important de subir à nouveau des violences, et aussi d’en commettre contre elles-mêmes, et pour un petit nombre d’entre elles contre autrui, ce qui suffit à alimenter sans fin un cycle des violences. L’OMS a reconnu en 2010 que le facteur principal pour subir ou commettre des violences est d’en avoir déjà subi.
Reproduire les violences qu’on a subies sur des enfants est terriblement efficace pour s’anesthésier émotionnellement et écraser la petite victime qu’on a été et que l’on méprise, on bascule alors dans une toute puissance qui permet d’échapper à sa mémoire traumatique et d’échapper à des états de terreur ou de peur permanente. Il s’agit d’une stratégie dissociante. Mais si, quand on est traumatisé et laissé à l’abandon sans soin ni protection, on ne peut être tenu responsable d’être envahi par une mémoire traumatique qui fait revivre les violences, et de mettre en place des stratégies de survie telles que des conduites d’évitement, de contrôle et/ou des conduites dissociantes, en revanche on est responsable du choix qu’on opère de les utiliser contre autrui en l’instrumentalisant comme un fusible pour disjoncter.
Quand la mémoire traumatique de l’agresseur revient hanter la victime avec sa haine, son mépris, son excitation perverse, soit la victime peut courageusement se battre pour contrôler sans relâche ce qu’elle pense être ses propres démons (alors qu’il ne s’agit pas d’elle, de ce qu’elle est, mais d’une remémoration traumatique intrusive qui s’impose à elle sans qu’elle puisse l’identifier comme telle, et qui se présente comme des phobies d’impulsion, avec la peur de passer à l’acte) en s’auto-censurant et en évitant toutes les situations qui peuvent déclencher des images ou des sensations intrusives (comme des situations sexualisées, comme être avec des enfants, les toucher), soit elle peut retourner ces intrusions contre elle et se haïr, se mépriser et s’auto-agresser sexuellement pour disjoncter et s’anesthésier, soit elle peut faire corps avec ces intrusions, s’identifier à elles et passer à l’acte sur autrui en reproduisant les actes commis par son agresseur, ce qui va là aussi lui permettre de disjoncter et s’anesthésier avec en prime un sentiment de toute-puissance et le risque d’une véritable addiction à la violence sexuelle. Pour un enfant il est difficile de lutter contre ces envahissements incompréhensibles, mais pour un adulte le choix de ne pas passer à l’acte sur autrui, de ne pas gravement transgresser les lois, de ne pas mépriser les droits de la victime et sa souffrance, est toujours possible, impliquant cependant de mettre en place en soi tout un arsenal de contraintes.
Par ailleurs il est évident que c’est bien parce que les enfants n’ont pas été protégés, ont été abandonnés sans soins appropriés qu’ils doivent composer avec une mémoire traumatique redoutable qui les oblige à s’auto-censurer sans cesse, à vivre dans une guerre permanente. Leur mémoire traumatique aurait dû être traitée et transformée en mémoire autobiographique, ce qui les aurait libérés de la torture que représentent des violences et des agresseurs continuellement présents en soi.
III Sortir du déni, protéger et soigner les enfants victimes de violences, informer et former les professionnels : une urgence en terme de respect des droits fondamentaux, de justice et de santé publique.
Par ailleurs il est évident que c’est bien parce que les enfants n’ont pas été protégés, ni reconnus (83% d’entre eux selon notre enquête IVSEA, 2015), ont été abandonnés sans soins appropriés qu’ils doivent composer avec une mémoire traumatique redoutable qui les oblige à s’auto-censurer sans cesse, à vivre dans une guerre permanente. Leur mémoire traumatique aurait dû être traitée et transformée en mémoire autobiographique, ce qui les aurait libérés de la torture que représentent des violences et des agresseurs continuellement présents en soi.
La grande majorité des enfants n’a pas pu parler des violences subies avant des années, voire des dizaines d’années. À la question du questionnaire d’auto-évaluation de l’impact et de la prise en charge des victimes de violences sexuelles que notre association a mis en ligne "Pourquoi vous n’avez pas pu en parler", les réponses sont par ordre de fréquence :
- la difficulté à mettre des mots sur ce qui s’est passé et à l’identifier,
- le sentiment de culpabilité («je pensais que c’était de ma faute»)
- la peur de ne pas être cru-e
- l’impossibilité d’en parler du fait de la souffrance que cela réactive
- la peur des menaces de l’agresseur
- l’amnésie traumatique
- la peur des réactions de l’interlocuteur.
Il faut aider les victimes à parler, pour cela il faut communiquer sur la réalité des violences sexuelles et sur leur conséquences, les informer sur la loi, les droits des personnes, il faut, et c’est essentiel, leur poser des questions. Et quand elles arrivent à parler, il faut les écouter, les croire, reconnaître les violences sexuelles subies et les traumas qu’elles présentent, les protéger, être solidaire et leur apporter protection, soutien et soin. Il est très important de leur donner des informations et d’expliquer les mécanismes psychologiques et neurobiologiques psychotraumatiques pour que les victimes comprennent ce qui leur arrive, pour qu’elles puissent se déculpabiliser et avoir une boîte à outils pour mieux se comprendre.
Tous ces symptômes psychotraumatiques qui traduisent une grande souffrance chez les victimes de violences sexuelles, sont encore trop méconnus. En France, en 2015, les médecins et les autres professionnels de la santé ne sont toujours pas formés ni en formation initiale - lors d’une enquête récente auprès des étudiants en médecine plus de 80 % ont déclaré ne pas avoir reçu de formation sur les violences et 95% ont demandé une formation pour mieux prendre en charge les victimes de violences - ni en formation continue, et l’offre de soins adaptés est très rare (enquête, ). Comme nous l’avons vu de nombreux diagnostics psychiatriques seront portés à tort et des traitement essentiellement dissociants et anesthésiants proposés (psychotropes à hautes doses, méthodes psychothérapiques dissociantes), quand ils ne sont pas violents (enfermement, isolement, contention…).
Tous ces troubles psychotraumatiques sont régressifs dès qu’une prise en charge de qualité permet de traiter la mémoire traumatique. La méconnaissance de tous ces mécanismes psychotraumatiques, l’absence de soins, participent donc à l’abandon où sont laissées les victimes, à la non-reconnaissance de ce qu’elles ont subi, à leur culpabilisation, à leur mise en cause et à de fréquentes maltraitances. Les victimes, condamnées à organiser seules leur protection et leur survie, sont considérées comme responsables de leur propres malheurs.
Des soins essentiels
Les soins sont essentiels, la mémoire traumatique doit être traitée. Il s’agit de faire des liens, de comprendre, de sortir de la sidération en démontant le système agresseur et en remettant le monde à l’endroit, de, petit à petit, désamorcer la mémoire traumatique, de l’intégrer en mémoire autobiographique, et de décoloniser ainsi la victime des violences et du système agresseur.
La prise en charge thérapeutique doit être la plus précoce possible. En traitant la mémoire traumatique, c'est-à-dire en l'intégrant en mémoire autobiographique, elle permet de réparer les atteintes neurologiques, et de rendre inutiles les stratégies de survie.
Le travail psychothérapique consiste à faire des liens, en réintroduisant des représentations mentales pour chaque manifestation de la mémoire traumatique (perfusion de sens), ce qui va permettre de réparer et de rétablir les connexions neurologiques qui ont subi des atteintes et même d’obtenir une neurogénèse. Il s’agit de « réparer » l’effraction psychique initiale, la sidération psychique liée à l’irreprésentabilité des violences. Effraction responsable d’une panne psychique qui rend le cerveau incapable de contrôler la réponse émotionnelle, ce qui est à l’origine du stress dépassé, du survoltage, de la disjonction, puis de l’installation d’une dissociation et d’une mémoire traumatique. Cela se fait en « revisitant » le vécu des violences, accompagné pas à pas par un « démineur professionnel » avec une sécurité psychique offerte par la psychothérapie et si nécessaire par un traitement médicamenteux, pour que ce vécu puisse petit à petit devenir intégrable, car mieux représentable, mieux compréhensible, en mettant des mots sur chaque situation, sur chaque comportement, sur chaque émotion, en analysant avec justesse le contexte, ses réactions, le comportement de l’agresseur, ce qui permet de sortir de la dissociation et de déminer la mémoire traumatique (Boon, 2014 ; Salmona, 2013). Il s’agit de remettre le monde à l’endroit. Il faut démonter tout le système agresseur, et reconstituer avec l'enfant son histoire en restaurant sa personnalité et sa dignité, en les débarrassant de tout ce qui les avait colonisées et aliénées (mises en scènes, mensonges, déni, mémoire traumatique). Pour que la personne qu'il est fondamentalement puisse à nouveau s'exprimer librement et vivre tout simplement. Pour que l'enfant terrorisé ne soit enfin plus jamais seul. "Pour abattre le mur du silence et rejoindre l'enfant qui attend" (Alice Miller, 1992).
Cette analyse poussée permet au cerveau associatif et à l’hippocampe de re-fonctionner et de reprendre le contrôle des réactions de l’amygdale cérébrale, et d’encoder la mémoire traumatique émotionnelle pour la transformer en mémoire autobiographique consciente et contrôlable. De plus il a été démontré qu’une prise en charge spécialisée permettait de récupérer des atteintes neuronales liées au stress extrême lors du traumatisme, avec une neurogenèse et une amélioration des liaisons dendritiques visibles sur des IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) (Ehling, T., . 2003).
Rapidement, ce travail se fait quasi automatiquement et permet de sécuriser le terrain psychique, car lors de l’allumage de la mémoire traumatique le cortex pourra désormais contrôler la réponse émotionnelle et apaiser la détresse, sans avoir recours à une disjonction spontanée ou provoquée par des conduites dissociantes à risque. Il s’agit pour le patient de devenir expert en « déminage » et de poursuivre le travail seul, les conduites dissociantes ne sont plus nécessaires et la mémoire traumatique se décharge de plus en plus, la sensation de danger permanent s’apaise et petit à petit il devient possible de se décoloniser de la mémoire traumatique et de retrouver sa cohérence, et d’arrêter de survivre pour vivre enfin.
Conclusion
Il est donc essentiel de protéger les enfants des violences et d'intervenir le plus tôt possible pour leur donner des soins spécifiques, il s'agit de situations d'urgence pour éviter la mise en place de troubles psychotraumatiques sévères et chroniques qui auront de graves conséquences sur leur vie future, leur santé, leur scolarisation et socialisation, et sur le risque de perpétuation des violences.
Et il est nécessaire de promouvoir les droits des enfants et l’égalité femmes-hommes, d’améliorer le fonctionnement de la protection de l’enfance et de la justice, et de lutter contre l’impunité. Il est tout aussi nécessaire de sensibiliser et de former tous les professionnels de l'enfance, des secteurs médico-sociaux, associatifs et judiciaires sur la réalité des violences et de leurs conséquences psychotraumatiques. La prévention des violences passe avant tout par la protection et le soin des victimes. Parce qu’ils ne seront plus condamnés au silence, ni abandonnés sans protection et sans soins, ces enfants victimes pourront sortir de cet enfer où les condamne la mémoire traumatique des violences sexuelles subies.
C’est une véritable révolution qu’il faut donc opérer, en passant d’une situation où presque aucune de ces personnes victimes de violences sexuelles n’est repérée, et où les rares qui parlent ne sont pas entendues, ni crues, à une situation où la préoccupation majeure sera d’assurer leur protection en les questionnant toutes fréquemment, pour savoir ce qu’elles vivent et subissent, et en accordant ainsi une valeur importante à leur témoignage.