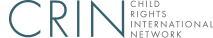Soumis par crinadmin le
Summary: Dans la plus grande maison close du pays, à Daulatdia, vivent 1 500 prostituées et leurs 600 enfants. Si les petites filles rêvent d’être hôtesse de l’air ou prof, elles sont pour la plupart vouées à reprendre, parfois très jeunes, le flambeau maternel.
[Le 30 juin 2013] - Avec ses 15 ans, son sourire magnifique et son sari beige, Jesmin est belle comme une princesse. La jeune fille modèle vient de réussir son examen scolaire et rêve de devenir avocate. Mais Jesmin est une fille du bordel de Daulatdia, au Bangladesh. Elle y est née, sa mère s’y prostitue, et elle-même tente d’échapper à ce destin. Pour l’instant, elle se sait privilégiée : seuls quelques dizaines d’enfants de «travailleuses du sexe» grandissent à l’abri dans une safe house, un centre d’hébergement attenant au bordel. Une ONG locale, Piact (1), en accueille seize. «Même si c’est encore trop près du bordel, j’aime être ici. Personne ne va nous agresser ou nous insulter», raconte Jesmin. Pas comme les enfants nés et vivant au bordel : «Ce sont des victimes», dit-elle. Ouvert 24 heures sur 24 Daulatdia est le plus grand des quatorze bordels officiellement répertoriés au Bangladesh, situé à 100 km à l’ouest de Dacca, la capitale. On y compte 1 500 prostituées et 600 enfants vivant avec elles. En tout, 15 000 à 20 000 enfants grandiraient dans les bordels du pays. Et il s’avère très difficile de briser le cercle vicieux qui conduit les filles à emprunter le chemin de la prostitution. Selon Jesmin, «les mères ne veulent pas que leurs filles fassent le même travail». Mais à son âge, beaucoup vendent leur corps. Selon l’ONG Save the Children, 240 enfants se prostituent à Daulatdia. Le bordel, un village formé de casemates serrées autour de cours exiguës, s’organise autour de l’étroite allée centrale et de ses commerces - restos, bars, pharmacie, épicerie . Trois mille personnes vivent ici, mais aucun espace n’existe pour accueillir les enfants. Aujourd’hui, jour de pluie et de vent, on avance dans l’eau et la boue, ce qui n’empêche pas les filles de nous aguicher. Elles sont souriantes, très jeunes, parfois belles. Les clients débarquent du train qui s’arrête tout près, ou arrivent du terminal des ferries traversant le fleuve Padma. Ouvert 24 heures sur 24, le bordel, legs de la colonisation anglaise, est situé fort habilement à un nœud de circulation où transitent des dizaines de milliers de personnes. Il offre une halte commode aux voyageurs. On a rendez-vous au local d’Amosus, l’association créée en 2004 par les travailleuses du sexe pour défendre leurs droits. Elle revendique 825 adhérentes, qui payent 100 taka (10 centimes d’euro) par mois pour avoir leur carte. Moni, la présidente, raconte : «Avant, les enfants du bordel ne pouvaient pas aller à l’école, et nous, on n’avait pas le droit d’en sortir en chaussures. Quand une travailleuse du sexe décédait, on ne pouvait pas l’enterrer au cimetière. On n’avait pas d’eau potable, pas d’électricité, pas de sanitaires. On ne pouvait même pas voter.» Les femmes ont conquis ces droits, aidées par diverses ONG. «On avait aussi des ennuis avec la police, qui rentrait ici et prenait notre argent, ou même avec les journalistes. Et les voisins nous harcelaient», poursuit Moni. Grâce au travail avec les élus et la société civile, les mentalités évoluent. Les prostituées sont mieux acceptées, mais la méfiance demeure envers elles et leurs filles, souvent insultées au nom de «Notir Meye» («filles du bordel»). Et si les autorités locales leur ont accordé le droit de vote, c’est, selon une étude de Save the Children (2), pour mieux récupérer les voix du bordel, dont elles tirent aussi de solides subsides en extorquant les travailleuses. A Daulatdia, il n’y a plus de service de santé, juste une petite pharmacie. Un médecin qui vient de l’extérieur réalise «deux à trois avortements par jour», selon Save the Children. Les préservatifs sont disponibles, mais certains clients préfèrent payer plus pour un rapport sans protection (5 euros au lieu de 2). Autre souci : «Les travailleuses du sexe gagnent de l’argent, mais quand elles seront vieilles, comment feront-elles ? se demande Moni. Il faut qu’on leur trouve un travail pour qu’elles continuent à avoir un revenu.» A défaut, les filles prennent le relais d’une mère jugée trop vieille. La retraite sonne souvent dès 30 ans. C’est pourquoi Moni voudrait les éloigner : «Les enfants partent à l’école le matin à 9 heures, reviennent à 17 heures. Et là, ils peuvent observer toutes nos activités. C’est très mauvais, ça crée des problèmes psychologiques. On veut des centres d’hébergement pour qu’ils grandissent à l’extérieur.» Malheureusement, cela coûte cher, et les ONG ont de moins en moins de fonds. Alors, «les filles se mettent à la prostitution», admet Moni. Cela commence tôt : elle-même est arrivée avec sa mère à 12 ans. A 15 ans, elle tapinait. Elle compte aujourd’hui trente ans d’ancienneté. A Daulatdia, la vie s’écoule au rythme des cris des enfants, assis sur des tabourets auprès de leurs mères qui discutent avec les clients. Le bordel, qui compte 1 965 chambres selon une ONG, est un monde fermé. Chaque femme loue une petite chambre où elle vit et travaille. Lors des passes, elle fait juste sortir son enfant. La location journalière pour une pièce bien aménagée, coquette et confortable parfois, coûte 2 euros. Il y a aussi des chambres pourries à 50 centimes d’euro. 50 euros pour déflorer une vierge Au Bangladesh, la prostitution n’est ni légale ni illégale, explique le sociologue A.S.M. Amanullah. Dans un bordel, elle est autorisée pour les femmes de plus de 18 ans disposant d’un certificat établi par un magistrat. Et contre un billet, ce dernier ne se montre pas très regardant sur l’âge réel. C’est ainsi que des filles de 13 ans y travaillent. Les policiers ne sont d’aucun secours: selon les témoignages, ils rackettent les prostituées, consomment à l’œil et ne s’interposent pas quand la violence, fréquente, éclate. «La police fait partie du business, indique le sociologue. Souvent, ce sont les plus gros clients, et ils ne payent pas forcément. Parfois, les filles sont victimes de viols en réunion de leur part.» Les filles de 13 à 18 ans sont les plus prisées, selon diverses études (3). En moyenne, la prostitution commence à 13 ans, parfois dès 11 ans, avec les filles du bordel ou d’autres introduites illégalement. «Les policiers reçoivent 10 000 ou 20 000 taka [100 ou 200 euros] de pot-de-vin pour laisser entrer des enfants au bordel», confie Amanullah. Des leaders politiques locaux participent au recrutement. Dans cet univers immuable, les mères jouent un rôle complexe. Selon une anthropologue canadienne, Thérèse Blanchet, certaines s’arrogent le droit de «disposer de la sexualité de leurs filles». Souvent, celles-ci commencent à danser pour les clients dès 8 ou 10 ans, contre rétribution. C’est aussi, souvent, l’âge des premières expériences sexuelles. Déflorer une jeune vierge se paye 50 euros : la mère se charge de trouver le client. Dès qu’elles ont leurs règles, les filles sont «enregistrées» auprès des mères maquerelles. Pour paraître plus âgées et appétissantes, les plus jeunes prennent de l’oradexone, un stéroïde qui fait grossir notamment les seins et les hanches, et déforme les traits du visage. Certaines filles subissent l’existence de chukri, des esclaves achetées par des dalals («maquereaux») : elles ne gardent rien de l’argent qu’elles rapportent. Malgré cette prostitution enfantine, les bordels sont durablement installés dans les creux hypocrites d’une société par ailleurs pieuse et conservatrice. «Ils ne sont menacés que quand certains intérêts alentour veulent récupérer la terre, comme récemment dans le district de Madaripur, explique Enamul Haque, de l’ONG Piact. Mais on a porté plainte, et ça s’est calmé.» Selon le sociologue Amanullah, «il y a eu un mouvement dans les années 90 pour leur fermeture, mais la société civile ne l’a pas soutenu.» Et les femmes elles-mêmes n’en veulent pas : «Si on n’était pas dans ce métier, qu’est-ce qu’on ferait ? demande Moni. Ça ne nous intéresse pas de partir.» Certaines essayent, mais échouent. Laksmi (un pseudo), 35 ans, sari et paupières roses, travaille ici depuis quatre ans. A son fils de 11 ans qui grandit dans le centre d’hébergement à côté, elle raconte qu’elle est travailleuse sociale. «Mais je pense qu’il a compris ce que je fais», avoue-t-elle. Pour sortir d’ici, Laksmi s’était mariée avec un babu, un client régulier qui l’a emmenée chez lui. Mais il a entamé une relation avec une autre prostituée et Laksmi l’a quitté. «J’ai essayé de trouver un emploi à Dacca. Impossible : je n’ai jamais fait d’autre travail.» Elle est revenue au bordel. Il est 18 heures, Laksmi va bientôt commencer son activité. «Après 20 heures, il y a de la bière et du vin. Les filles dansent, les clients payent. Je bois un peu, je me sens mieux. Certaines prennent du yaba [des amphétamines, ndlr] ou du Phensedyl [un sirop contre la toux contenant de la codéine], pas moi.» Elle gagne 2 euros pour un rapport (quinze minutes), 5 euros pour deux rapports (une heure). «Les autres filles ont un mec et lui donnent tout leur argent, "au nom de l’amour". Cela les sort de la solitude et les sécurise.» Sinon elles dépendent de mères maquerelles. Laksmi, elle, se veut indépendante : «Je préfère garder mes sous pour subvenir aux besoins de mon fils et de ma mère au village.» Là-bas, ils pensent qu’elle travaille dans le textile. Quand elle va les voir, Laksmi met le hijab. Pour être tranquille. «Je n’aime pas le bordel, mais je ne vois pas comment je pourrais en sortir, dit-elle. Beaucoup de clients nous font miroiter des rêves : "Viens avec moi, je te trouverai un job." Mais ça dure trois mois et c’est fini.» Pour échapper à ce destin, Jesmin, la jeune fille modèle, espère continuer ses études. Comment ? La question du financement s’avère cruciale. «Ma mère essaye de m’aider, mais elle n’a pas assez d’argent.» En fait, elle l’a plus ou moins abandonnée. Jesmin ne lui en tient pas rigueur. «Elle n’aime pas cette profession, mais elle n’a pas d’autre moyen de vivre. Je veux la sortir de là. Si je peux avoir un bon job, j’y arriverai.» Autour d’elle, les filles du centre d’hébergement rêvent d’être médecin, prof ou hôtesse de l’air. Mais elles savent quel sort les guette de l’autre côté du mur et lancent un cri d’alarme : «Il nous faut plus de soutien pour nous aider !» (1) Program for the Introduction and Adaptation of Contraceptive Technology. (2) Amanullah, A.S.M. and Huda, N. (2012). «Study on the Situation of Children of Sex Workers in and Around Daulatdia Brothel.» Save the Children International, Dacca. (3) Lire «Sex Workers and Their Children in Bangladesh», Centre de développement durable, University of Liberal Arts, Dacca, novembre 2012. Plus d'informations : La retraite à 30 ans
Amphétamines et sirop contre la toux